DossierLes partenariats public-privé (PPP), mode d'emploi
Développer le financement privé d'infrastructures assurant ou contribuant au service public. Tel est l'objectif des contrats de partenariats. Retour sur un outil de financement lancé en juin 2004.
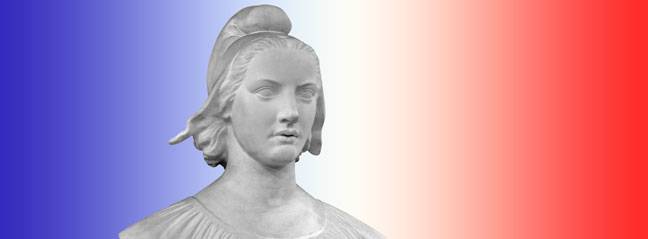
Sommaire
- Le PPP, un outil de financement qui convainc progressivement
- Partage des risques et créativité…
- Accompagner les collectivités
- Pour aller plus loin
- Les PPP, une opération gagnante ?
- 71% des projets livrés dans les délais
- Des budgets respectés
- Pour aller plus loin
- [TRIBUNE D'EXPERT]: Les PPP, une aubaine ou une malédiction pour l'État ?
- Pouvez-vous refaire un point sur l'historique des PPP?
- Quelles bonnes pratiques pourraient éviter les récents ratés des PPP (Ballard, Vinci...) ?
- Quels sont les facteurs-clés du succès ou de l'échec d'un PPP ?
- Quelle est la réflexion menée ce sujet à l'échelle européenne sur les PPP ?
- Quelques cas d'école…
1 Le PPP, un outil de financement qui convainc progressivement
Projet Balard du ministère de la Défense ou partenariat public-privé (PPP) du centre hospitalier sud-francilien (CHSF) à Corbeil-Essonnes… Ces cas d’école “ratés” de partenariats public-privé ont mis en relief les écueils de ces outils de la commande publique. Retards de chantier, favoritisme dans l’attribution du contrat… les attaques sont nombreuses. Le 2 février 2012, lors d’un débat à l’Assemblée nationale, plusieurs députés du Front de Gauche, conduits par le communiste Roland Muzeau, avaient dénoncé le manque de transparence et l’insuffisance des contrôles des partenariats public-privé.
2 Partage des risques et créativité…
Au départ, le contrat de partenariat (CP) est adapté aux projets complexes qui nécessitent de lourds investissements. Cet outil de la commande publique permet de rassembler les acteurs de la conception à la réalisation, la maintenance, l’exploitation et la gestion de l’ouvrage en amont du projet.
Pour Pierre-Emeric Chabanne, délégué général de l’Institut de la gestion déléguée (IGD), fondation d’entreprises spécialisée dans la gouvernance et performance des services publics : « Les avantages du CP sont multiples. Ce partenariat permet à la personne publique de ne payer qu’à partir de la livraison de l’ouvrage et de répartir son paiement dans le temps. Ce dernier avantage incite, en retour, le cocontractant à réaliser l’ouvrage dans les plus brefs délais. » Paiement différé pour les collectivités, partage des risques… les atouts des PPP ont été maintes fois mis en avant. Des partages des risques, mais également des objectifs de performance qui engendrent des recettes annexes, ne pouvant « qu’inciter le cocontractant à rechercher l’efficience » selon le directeur général de l’IGD.
De son côté, le ministre alors en charge de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, Éric Besson, voit1 dans les PPP « un dialogue compétitif, qui permet de tirer le maximum d’innovation et de créativité du secteur privé » ainsi qu’une « garantie contractuelle de bon entretien à long terme du patrimoine concerné ». Si se délester des prestations de maintenance ou de gestion auprès du secteur privé peut être mal perçu, pour Olivier Pedro-José, porte-parole adjoint du ministère de la Justice et des Libertés : « Cela permet notamment aux établissements pénitentiaires de se concentrer sur leur cœur de métier. »
3 Accompagner les collectivités
Pour mener au mieux ces contrats de partenariat, de bonnes pratiques s’imposent. Michaël Perez, consultant expert marchés publics France chez MPF, entité française du groupe européen EBP, spécialisé dans l’accompagnement en marchés publics pour les entreprises, préconise « une définition claire des besoins et une étude approfondie d’équilibre économique ». Avant d’ajouter : « Mais il faut aussi savoir anticiper les financements sur 20 ans. »
Dans ce type de contrat, le montage financier est le nerf de la guerre. Si une révision annuelle des loyers est permise, il faut prêter attention aux taux d’intérêt. Sans oublier « l’importance de fixer des pénalités de retard dissuasives », souligne le consultant expert marchés publics France, c’est-à-dire suffisamment élevées pour que le cocontractant respecte les délais de livraison fixés. En résumé, avance Michaël Perez, il s’agit surtout de « penser à tout dès le départ pour ne pas bouleverser l’économie du marché ».
Concernant les écueils à éviter, Maître Laurent Frölich, avocat chez Palmier & Associés et expert en marchés publics chez MPFrance, met en évidence le « problème de la rupture d’égalité lors de la mise en concurrence ». « Un détail insidieux », souligne-t-il. Un simple remaniement du cahier des charges ou une information supplémentaire communiquée à un répondant à l’appel d’offres et non à l’ensemble des concurrents peut engendrer des complications judiciaires. Aujourd’hui, le PPP est encore un outil jeune. Et pour Pierre-Emeric Chabanne de l’IGD, « le dispositif du CP peut encore être amélioré. Ses coûts d’ingénierie sont encore trop élevés quand il s’agit de projets de petite taille ». Fort de ce constat, l’IGD et ses partenaires mènent un groupe de travail sur la simplification de cet outil afin de rendre l’ingénierie moins lourde, de l’adapter aux besoins des collectivités et de l’ouvrir aux PME.
Côté formation, le cabinet MPFrance propose d’accompagner les collectivités. « Aujourd’hui, un acheteur dans une administration n’a ni le temps ni les moyens pour se consacrer à la rédaction d’un tel contrat, précise Michaël Perez. Si une entreprise peut être amenée à répondre à plusieurs appels d’offres, ce n’est pas le cas des collectivités qui peuvent ne passer qu’un à deux contrats de partenariat en 20 ou 30 ans. » Maître Laurent Frölich plaide pour « quatre entités pour accompagner les collectivités, soit : des juristes, des économistes, des financiers ainsi que des techniciens ».
Aujourd’hui, selon Michaël Perez de MPF, si « 90 % des administrations se forment en externe, les sociétés, elles, se forment en interne ». Par ailleurs, une formation sur les PPP a vu le jour en 2008 avec la création de l’école des PPP. Elle est le fruit d’un partenariat entre la Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP), l’Institut de la gestion déléguée (IGD), les universités Paris II (Panthéon-Assas), Paris X (Paris-Ouest-Nanterre) et l’École nationale des ponts et chaussées (ParisTech). « Si cette formation était originellement destinée aux acteurs du service public, des acteurs privés se sont montrés intéressés. Désormais, elle est ouverte à tous », conclut Pierre-Emeric Chabanne de l’IGD.
1/ Intervention du ministre le 2 février 2012, lors d’un débat à l’Assemblée nationale.
4 Pour aller plus loin
Tout contrat passé entre une administration et une entreprise privée doit faire l'objet d'une fiche de recensement, communiquée à l'Observatoire économique des achats publics. À l'exclusion, en 2012, des sous-traitants.
En savoir plus sur la réglementation.
Outil de la commande publique, les partenariats public-privé séduisent peu à peu les autorités publiques. Mais comment fonctionne ce mode de financement ? Quelles sont les bonnes pratiques à respecter ? Explications.
5 Les PPP, une opération gagnante ?
Les contrats de partenariat ou assimilables (CPA), souvent désignés sous le terme «Partenariats public-privé» (PPP), seraient de plus en plus plébiscités par les acteurs publics comme privés. Tel est le résultat d’une étude* réalisée par PwC, spécialiste du conseil en management, en collaboration avec l’École nationale des ponts et chaussées et avec le soutien de la Mission d’appui aux partenariats public-privé. «Si 2010 s’illustre comme l’année de la plus forte croissance, constituant plus de 37% du total d’investissement des projets signés depuis 2005, on s’attend pour 2011 à un cru prometteur. La France est ainsi devenue au 1er semestre 2011 le premier marché européen des PPP en valeur», déclare Christian Rasoamanana, associé PwC responsable PPP et financement de projet, et coordinateur de l’étude.
La valeur des contrats signés évolue également. Alors qu’ils représentaient 100% des contrats signés en 2005, aujourd’hui seuls 42% d’entre eux portent sur un montant d’investissement inférieur à 30 millions d’euros. En parallèle, on assiste depuis 2009 à l’essor des projets d’un montant d’investissement supérieur à 100 millions d’euros. En termes de secteurs d’activité, celui du bâtiment est le premier concerné par les CPA, avec 41% des projets signés depuis 2004. Viennent ensuite le secteur des travaux publics (33% des contrats signés), de l’énergie et des services (26%).
6 71% des projets livrés dans les délais
7
En matière de respect des délais, les CPA s’avèrent particulièrement performants, puisque 71 % des projets sont aujourd’hui délivrés dans les délais. Ce taux atteint même 79% si l’on tient compte des décalages imputables exclusivement au partenaire public (respect des délais par le partenaire privé). Ce chiffre cache dans près d’un cas sur trois des retards intermédiaires en cours d’exécution, que les partenaires privés ont été en mesure de résorber par une réorganisation ou des moyens supplémentaires, témoignant ainsi de leur capacité d’adaptation et de la forte incitation à respecter les délais contractuels. La sévérité des retards est maîtrisée, puisqu’un peu moins d’un retard sur deux est inférieur à trois mois. Quant aux retards supérieurs à 12 mois, ils concernent principalement des projets faisant l’objet de livraison par tranches, comme les projets d’éclairage public. Le retard ne porte donc pas sur l’intégralité du projet.
Pour maîtriser le calendrier, la bonne gestion de projet (maîtrise d’ouvrage et implication du partenaire public dans l’appui et le suivi du projet) s’avère le facteur clé de succès le plus important. Viennent ensuite le caractère incitatif du mécanisme de paiement (le partenaire privé avance tous les frais et ne commence à être remboursé par le partenaire public qu’à la livraison de l’ouvrage) et la constitution de provisions suffisantes permettant d’endosser d’éventuelles dérives de planning.
Lire aussi : L'acheteur du futur, un acheteur stratége ?
8 Des budgets respectés
9
Autre argument en faveur des CPA : moins de 10 % des projets présentent un surcoût supérieur à 3 % du coût initial pour le partenaire public. Et parmi les projets restants (91%), 53% ont parfaitement respecté le coût d’investissement initial à la livraison finale de l’ouvrage. Parmi les facteurs de maîtrise des coûts, on trouve encore en tête la bonne gestion de projet, avant la nature forfaitaire du contrat de conception-construction, la qualité de l’estimation initiale et la définition claire des besoins et responsabilités dans le contrat.
Principale cause de ces surcoûts : les modifications demandées par le partenaire public. « Il s’agit plus d’ajustements demandés par les utilisateurs (confort d’aménagement) que de modifications lourdes », explique Christian Rasoamanana. Les autres surcoûts sont dus à des imprévus dont les conséquences restent prises en charge par le partenaire public (problèmes de sols, intempéries exceptionnelles, retard d’autorisation administrative, évolution réglementaire, etc.)
Selon Christian Rasoamanana : « L’étude n’a pas pu établir de corrélation systématique entre retards et surcoûts mais montre que le retard est un facteur aggravant de surcoût. L’un des constats surprenants tient au fait que si les retards touchent indifféremment les projets, en revanche, les probabilités de surcoûts diffèrent en fonction du profil des projets. Ainsi le risque de surcoût augmente avec la taille de l’investissement, accréditant l’idée que les “grands” projets, par leur complexité, présentent un risque de surcoût plus important. À l’inverse, ce risque peut diminuer selon la nature du projet. Ainsi le secteur des travaux publics semble surperformer puisque seuls 6% des projets avec des surcoûts appartiennent à ce secteur alors qu’ils sont 26% dans notre échantillon. »
*Cette étude a été réalisée entre février et juin 2011, et porte sur les Contrats depPartenariat au sens de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004, les Beaux Emphytéotiques Administratifs Hospitaliers (BEAH) ainsi que les Autorisations d’occupation temporaire et les Locations avec lption d’achat (AOT-LOA). Sur les 104 projets signés depuis 2004 recensés au 1er juin, 60 projets ont été sélectionnés pour leur représentativité. Afin de garantir la pertinence des résultats, seuls les contrats en phase d’exploitation ou de réalisation ont été retenus.
10 Pour aller plus loin
Après neuf ans d'existence, les partenariats publics-privés affichent un bilan plutôt positif. Les deux points les plus performants sont: la capacité à maîtriser le budget initial et le respect des délais prévus.
11 [TRIBUNE D'EXPERT]: Les PPP, une aubaine ou une malédiction pour l'État ?
12 Pouvez-vous refaire un point sur l'historique des PPP?
13
Stéphane Saussier: Les contrats de partenariats ont été lancés en juin 2004, en France, avec l'idée de développer le financement privé d'infrastructures donnant lieu à des services publics pour lesquels les opérateurs ne pouvaient être rémunérés directement par les usagers. Ce sont des contrats globaux, donnant lieu à des loyers de la part de la puissance publique en fonction de la capacité des opérateurs à atteindre des performances contractuellement établies. Si ces contrats se sont peu développés au début, notamment à cause de l'incertitude juridique les entourant, ils se multiplient aujourd'hui, avec plus de 120 contrats signés. Si les besoins de financements privés ne sont pas indifférents au lancement de ces nouveaux PPP, il n'en reste pas moins que ces contrats globaux ont de réels avantages économiques mais aussi des risques qu'il est nécessaire d'anticiper.
14 Quelles bonnes pratiques pourraient éviter les récents ratés des PPP (Ballard, Vinci...) ?
Un mauvais projet à l'origine, un manque de concurrence, des choix contractuels inadéquats, un suivi de la relation ex postNDLR, suivi ex post: après l'établissement d'un contrat (a contrario, on parlera de suivi ex ante ou avant contrat). défaillant menant à trop peu ou trop de renégociations. Toutes les étapes d'un PPP (choix du projet, évaluation préalable, dialogue compétitif, choix contractuels, suivi du contrat, adaptation de la relation contractuelle) sont cruciales et doivent être pensées rationnellement. C'est coûteux, mais c'est la condition pour qu'un PPP se passe bien. Les exemples de PPP contestés illustrent souvent qu'une de ces étapes n'a pas été prise au sérieux et que la dimension partenariale de ces accords est déficiente.
15 Quels sont les facteurs-clés du succès ou de l'échec d'un PPP ?
16
La capacité des acteurs à se poser les bonnes questions quant à l'utilité du projet, la manière de le mener (le contrat de partenariat n'est qu'un outil parmi d'autres), les écueils à éviter et leur volonté d'investir dans le partenariat, c'est-à-dire de ne pas considérer le PPP comme un moyen de déléguer le projet dans sa totalité vers l'extérieur. Nous avons maintenant des retours d'expériences significatifs sur les performances des PPP (en France et surtout en Grande-Bretagne sur les contrats de partenariats, en Europe et dans le monde sur les concessions et les marchés publics). Les risques à maîtriser et les moyens d'y parvenir sont largement connus.
17 Quelle est la réflexion menée ce sujet à l'échelle européenne sur les PPP ?
18
L'équivalent emblématique le plus proche du contrat de partenariat lancé est probablement le Pfi anglais, lancé au début des années quatre-vingt-dix. Plus largement, les PPP se développent dans bon nombre de pays européens et il existe, depuis 2007, une task force européenne chargée d'accumuler de l'expérience sur ces projets et de dégager les bonnes pratiques au niveau européen (l'EPEC - European PPP Expertise Centre). Le contrat de partenariat n'est donc pas une exception culturelle. Néanmoins, des différences existent d'un pays à l'autre. La France prend une place particulière puisque c'est le pays européen dans lequel le montant des PPP signés a été, pour la première fois au premier semestre 2011, le plus élevé (avec plus de 5,5 milliards d'euros).
Quels sont les avantages et les inconvénients de PPP ? Stéphane Saussier, professeur en charge de la formation dédiée aux PPP à l'IAE de Paris, apporte son éclairage.
19 Quelques cas d'école…
Donner accès au haut débit à tous les Girondins. Telle était la première étape du projet Haut Débit initié par le conseil général de Girondes. Ce projet d'envergure, le plus important en Aquitaine en matière de numérique, a permis de résorber les zones non couvertes et d'améliorer le débit dans d'autres zones.
La ville de Valenciennes retient ETDE pour son éclairage public
27,2 millions d'euros sur 20 ans. Tel est le montant du PPP que la ville de Valenciennes a signé avec ETDE, le pôle énergies et services de Bouygues Construction. Le contrat porte sur l'exploitation de l'éclairage public, la signalisation lumineuse et la mise en lumière du patrimoine architectural.
Corbeil-Essonnes joue la carte du PPP pour construire son groupe scolaire Paul-Langevin
La municipalité a décidé de recourir au PPP pour construire son groupe scolaire Paul-Langevin. Le montant des travaux est de 12,4 millions d'euros, la livraison devant intervenir dans un peu moins d'un an, pour la rentrée scolaire 2013.
Un projet Haut Débit pour le conseil général de Gironde, l'éclairage public pour la ville de Valenciennes, un groupe scolaire pour la municipalité de Corbeil-Essonnes… Trois projets qui ont fait l'objet d'un partenariat public-privé. Retour d'expériences…
Sur le même thème
Voir tous les articles Achats publics

![Ancrer une meilleure culture du dialogue entre acheteurs et [...]](https://cdn.edi-static.fr/image/upload/c_lfill,h_201,w_298/e_unsharp_mask:100,q_auto/f_auto/v1/Img/BREVE/2025/3/469568/ancrer-meilleure-culture-dialogue-acheteurs-fournisseurs-L.jpg)





